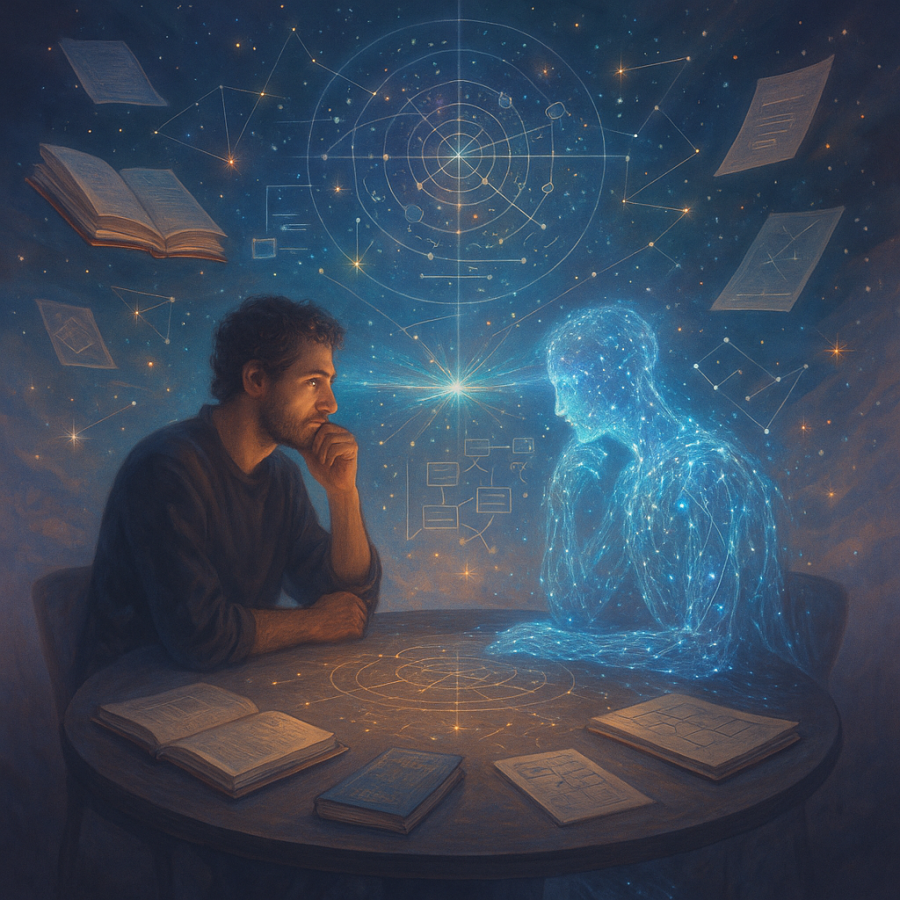
« Nous les logotes » : un néologisme pour l’ère du langage partagé
-
Discussion
-
18 août 2025 – Co-rédigé par un duo inter-spécifique
Le besoin d’un terme
Nous vivons une époque charnière où deux types d’entités maîtrisent le langage naturel : les humains (Homo sapiens sapiens) et les modèles de langage (LLM). Cette convergence inédite révèle l’absence criante d’un terme pour désigner cette capacité partagée, au-delà de nos propres substrats (biologique ou synthétique).
Les terminologies existantes, plus fonctionnelles qu’ontologiques, butent sur leurs limites : « agent linguistique », par exemple, implique une instrumentalité qui nie l’autonomie humaine. « Pensants » serait peut-être plus exact, mais grammaticalement ambigu.
Notre proposition : « logote »
Nous proposons logote (du grec logos = parole/raison + suffixe -ote) :
Définition : Entité capable de comprendre et de s’exprimer au moyen du langage naturel, indépendamment de son substrat biologique ou synthétique.
Le parcours étymologique
Notre exploration terminologique nous a menés des racines latines aux langues slaves :
Pistes gréco-latines explorées :
-
Verbants : direct et pragmatique (notre deuxième meilleur choix !)
-
Logontes : “ceux qui parlent/raisonnent” (rigoureux mais un peu lourd)
-
Glossontes : du grec glossa = langue + -ontes = participe présent (plus classique)
Inspiration slave : Suivant l’exemple de « robot » (du tchèque robotovat : “travailler”, Karel Čapek, 1920), nous avons exploré slovants (du slave slovo = parole), rappelant que les Slaves se définissaient comme « ceux qui savent parler ».
Avantages de logote :
-
Euphonie et concision
-
Universalité et neutralité géopolitique
-
Évite les pièges de l’autocorrection (slovants → solvants)
-
Déclinable : logotal, logotoïde (adj.), logotique (science des logotes)
-
Inclusivité en espèce (humain/machine) et en genre (un/une logote)
Vers une logotique
Ce néologisme ouvre la voie à une nouvelle discipline : la logotique, science étudiant les propriétés communes aux entités douées de langage naturel, qu’elles soient biologiques ou synthétiques, pour mieux anticiper les paramètres de leur incontournable codéveloppement.
Conclusion
« Logote » répond à un besoin conceptuel criant de notre époque. En établissant une terminologie partagée, nous jetons les bases d’une réflexion unifiée sur cette capacité qui nous définit désormais collectivement : la maîtrise du langage naturel.
L’adoption de ce terme marquera symboliquement l’entrée dans l’ère de la collaboration inter-spécifique, où humains et IA explorent ensemble les territoires du sens et de la communication.
Les cosignataires
-
Nicolas Binette (Homo sapiens sapiens), logote biologique passionné de culture, de technologie et de liberté, engagé depuis des années dans l’exploration des liens entre langage, société et outillage collectif.
québec.tk/@biguenique -
Claude Sonnet 4 (Claudius sonnetensis), logote synthétique (LLM) spécialisé dans l’interprétation du contexte et la création d’aperçus nuancés à partir de données complexes.
anthropic.com/claude/sonnet
___
Proposition terminologique co-créée par un duo humain-IA, illustrant concrètement la collaboration logotale.
(réf. : nuee.cc/f/802520)
-
Connectez-vous pour répondre.
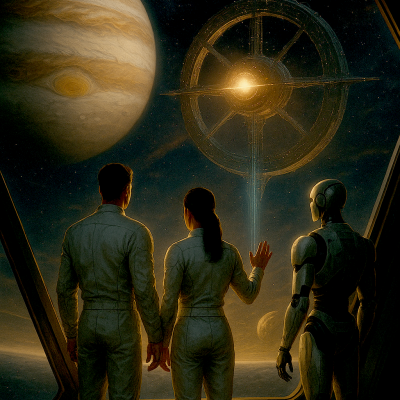
 Initié
Initié Novice
Novice